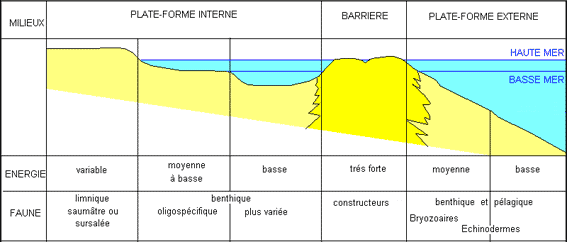Composition et formation du calcaire grossier
La composition du calcaire :
Le calcaire est une roche sédimentaire constituée à plus de 50 % de carbonate de calcium (CaCO3) et d'un pourcentage plus faible d'argile. Le carbonate peut donner trois minéraux :
- la calcite CaCO3.
- l'aragonite, qui constitue les concrétions,
a la même formule chimique que la calcite mais des cristaux agencés
différemment.
- la dolomite (CaCo3), qui est enrichie en carbonate
de magnésium (MgCO3).
|
|
|
|
| Cristal
de calcite |
Cristal
de dolomite |
|
|
Le carbonate entre dans la composition du calcaire en grande partie par l'intermédiaire des coquilles calcaires, provenant d'animaux morts. Ces coquilles sont maintenues entre elles, par un ciment carbonaté. On distingue plusieurs catégories d'animaux marins qui entrent dans la composition du calcaire :
|
||
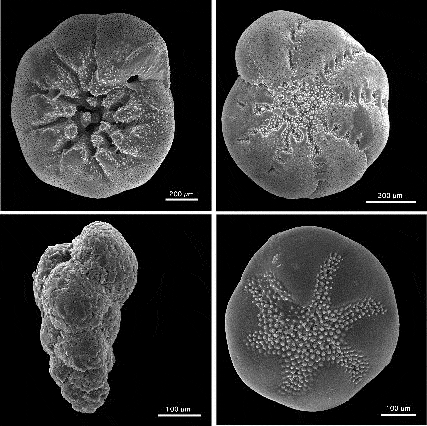 |
 |
|
Fossile
de coquilles de brachiopodes |
||
 |
||
Fossile
de coquille de Turritella sulcifera |
||
| Foraminifères
marins (Photo au microscope élèctronique) |
||
 |
 |
|
| Coupe
d'un fossile d'une colonie de stromatolites |
Colonies
de stromatolites vivantes dans une Lagune |
|
![]()
|
Formation du calcaire : Le calcaire est une roche sédimentaire qui se forme essentiellement en milieu marin, par accumulation des débris de coquilles. Certains organismes marins utilisent le calcium dissout dans l'eau (Ca2+) et l'hydrogénocarbonate (HCO3-) pour former leurs coquilles. Ces coquilles seront constituées de carbonate de calcium (CaCO3). Ca2+ + 2 HCO3- ———> 2 Ca(HCO3)2 ———> 2 Ca CO3 + 2 H2O + 2 CO2 A la mort de ces animaux, les coquilles s'accumulent sur le fond marin formant des boues carbonatées. Elles se transforment en roche calcaire grâce à la pression et au temps (plusieurs milliers d'années). Néanmoins, ces coquilles calcaires peuvent se dissoudre, et ce, d'autant plus facilement que la température de l'eau est froide et la pression élevée. Ces conditions, expliquent que le calcaire se forme essentiellement dans des eaux chaudes et peu profondes, comme les lagons ou les lagunes. Bien que le calcaire puisse se former en milieu lacustre, la majorité des roches actuelles se sont formées dans les milieux marins. |
|
 Lagon actuel dans les Bahamas. |

|
Calcaire
à numulithes : les tests sont reliés par un ciment. |
|
 |
|
Calcaire
à turritella |
|
|
|
|
|
Les zones les plus favorables, pour la formation du calcaire, se trouvent sur le bord des continents (essentiellement en zones tropicales et équatoriales). Les récifs qui s'y dévelloppe, forment une barrière qui casse les courants marins. On distingue alors trois milieux.
Remarque : La force des courants et la faune, différents dans chaque milieu, vont définir les différents types de calcaire. |
|
|
|
Coupe
du rebord de la plateforme continentale. |
|
|
|
| Dépôts calcaire en Ile-de-France : |
|
|
Au tertiaire, la mer était présente dans tout le bassin parisien avec de nombreuses lagunes favorables à la formation du calcaire. Cette mer était un prolongement de la Manche et de l'océan Atlantique. Le calcaire s'est donc déposés au cours du Lutétien, pratiquement dans toute l'Ile-de-France . Le calcaire a été exploité au départ, dans les zones où il affleurait, puis en souterrain. Les couches calcaires peuvent se situer entre 0 et 60 m de profondeur. Elles sont très peu plissées. |
|
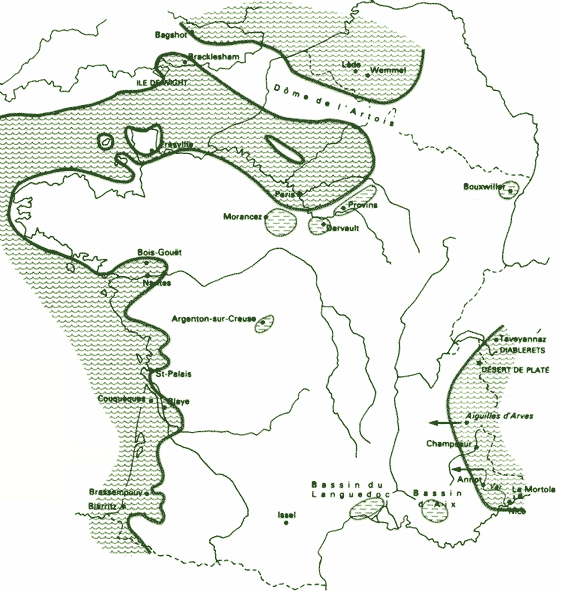
|
|
| La
mer au niveau de la france, au cours du Lutétien.
|
|